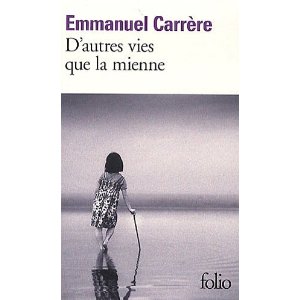(Billet spécialement dédié à Emma et Marc, qui furent des guides si précieux sur mon chemin de redécouverte de la danse toute l’année passée)
Mes pieds réapprennent le sol sous leur plante nue, soulagés de toute contrainte de cuir ou de toile. C’est la naissance de la danse, ce contact presque animal avec le bois du parquet, froid ou tiède selon la saison. J’y déroule mes talons, y imprime mes orteils un par un, dissociés et ravis d’être libres enfin. Parfois je leur offre l’herbe d’un jardin, le sable d’une plage solitaire, la pierre d’un rocher plat ; la danse est partout où je suis depuis bientôt un an. Mes pieds en sont les premiers avertis, tout mon corps suit après eux. J’arpente avec eux le lieu où elle va naître : avant toute chose repérer le terrain, l’apprivoiser, m’assurer de l’équilibre, du bien-être de ces pieds nus qui auront à glisser, à bondir, à tournoyer, à me soutenir et me propulser, alliés précieux.
Ma main gauche est partie chercher un bout de ciel. La droite explore l’espace en volutes douces, rejoint la première en caressant ma hanche au passage. Mes bras levés comme en incantation, mes doigts frémissent en chœur de cette quête du plus haut.
Ma taille ploie d’est en ouest, du sud au nord, d’un pôle à l’autre. Je sens mes vertèbres qui se déroulent, mes épaules qui tournoient à l’inverse de mon cou, mes hanches qui dessinent un huit cadencé, ou bien est-ce le symbole de l’infini ?
C’est le début de la danse, cette redécouverte de chaque membre, de chaque articulation, de chaque étage de mon corps. Mettre chacun en mouvement, s’assurer de leur souplesse, s’interdire la raideur, lâcher les tensions du jour, être attentive aux petites douleurs, aux petits empêchements, les respecter, ne pas forcer, étirer avec douceur, avec amour. Mon corps est un vieil ami dont je dois prendre soin, tendrement.
La danse naît souvent du sol, tout mon corps en contact avec la terre avant de s’élever plus haut, de voler peut-être, si le jour s’y prête. Moment de calme avant que le vent se lève, que le rythme se fasse plus soutenu, plus rapide, jusqu’à la tempête parfois. Oui, la danse est de ces vents qui nettoient les nuages, de ces pluies battantes qui épuisent et régénèrent. Un vivant ouragan.
Bien sûr il y a la musique, qui nous guide et nous entraîne. Mais je crois que je préfère entre tous les moments où je danse en silence, mue par ma seule envie, mon seul rythme, le battement de mon cœur et du sang dans mes veines. A l’écoute de mon souffle et du martèlement de mes pieds sur le sol, de l’air qui bruisse aux mouvements de mes bras, en lien intime avec le monde autour de moi.
Le premier rythme est fluide. Je glisse et dessine dans l’air des arabesques toutes en rondeurs, en douceur. J’entre dans la danse sans à-coups, sans forcer, en quête d’apaisement des secousses de la journée, des petites misères, de ma colère parfois. Celle-là aura son espace un peu plus tard pour s’évacuer et sortir de moi où elle ne fait que du mal.
Puis la cadence entre en scène, staccato lent ou syncopé. C’est le moment des formes nettes, des pieds qui tapent, des talons qui sonnent clair. L’énergie se propage, la fatigue se tait, le mouvement est roi, impérieux, nécessaire. C’est un appel au rythme et au courage de bouger comme on le sent au plus profond de soi. Faire taire la timidité ou l’inquiétude, le corps sait ce qu’il a à faire, ce qui est bon. Il n’y a pas de mauvais mouvement hormis celui qui le blesserait. C’est un éveil, un réveil, une expression de soi brute et sincère.
De celle-là, doucement ou vivement, émergera le chaos. Vif et lancinant, rapide et délivré de toute contrainte, il réclame l’abandon, le lâcher-prise, le cri. Je perds la notion de l’espace autour de moi, le sol se confond avec les murs, les autres danseurs sont des traces de couleurs vivantes et tressautantes. Nous communions au même rythme, chacun dans notre intérieur, dans notre chaleur, mais participant à une énergie commune. Nous dansons de tout notre cœur et nous créons un cœur commun, vibrant à l’unisson de nos sens, de nos sensations, de nos émotions, de nos colères, de nos chagrins ici projetés au loin, force centrifuge extraordinaire. Tournés tous vers le centre de la salle dans notre transe, je nous perçois parfois comme une galaxie tournoyante, la danse notre immensité.
Quand le rythme s’apaise, la danse se fait lyrique. Cadeau du chaos. De la fatigue naît un sentiment diffus de vérité. Il n’y a qu’à danser, mon corps sait des mystères que j’ignore. Je lui fais confiance, il va là où il doit aller, je le suis, ce n’est pas moi qui mène, pas ma tête en tous cas. Je flotte, je vogue, je tourne, je tournoie, je vagabonde, c’est léger et facile. Je suis bien.
Quiétude. Le temps s’arrête presque. Ralenti. Mes bras comme des algues à marée descendante, tranquilles jusqu’au bout des doigts. Souvent je retrouve le sol, havre bienvenu, mes jambes à leur tour cherchent le ciel, cherchent le repos, tremblantes parfois. Ce soir, plus tard, je prendrai un bain nocturne à la seule lueur de bougies, au son du silence ou peut-être d’un rien de Glenn Gould. Délassement, sommeil et rêves doux à venir.
La danse m’a accompagnée vingt années. Abandonnée vingt années ensuite. Mon genou blessé fut le précurseur d’autres blessures que j’ai affrontées sans danser. Aujourd’hui que les chagrins sont apaisés, les larmes séchées, je retrouve la danse non comme un exutoire mais comme une célébration, une joie sans faille. Je n’ai rien à évacuer, juste du plaisir à prendre. Juste du bonheur à vivre
Je danse, moi qui ne pensais plus jamais danser - mon genou aujourd’hui mon allié m’y autorise et a même l’air d’aimer cela puisqu’il se porte mieux que jamais. Je virevolte, moi qui ne pensais plus jamais virevolter. Et quand je valse autour de la salle, parfois, j’ai l’impression d’être dans des bras aimants, de rencontrer là, en réalité, les mots de mon amie Etty : je danse « dans les bras nus de la vie et j’y suis en sécurité… ses bras qui m’enlacent sont si doux et si protecteurs… et le battement de son cœur, je ne saurais même pas le décrire : si lent, si régulier, si doux, presque étouffé, mais si fidèle, assez fort pour ne jamais cesser, et en même temps si bon, si miséricordieux. » (Etty Hillesum - "Une vie bouleversée")