L’autre soir, j’ai loué un improbable film de filles. Le principe du film de filles, pour ceux qui ne seraient pas familiers de la chose, c’est un film où le héros et l’héroïne - plutôt jolis à regarder, en général - mettent une heure trente à réaliser qu’ils sont faits l’un pour l’autre, alors que nous on le sait depuis le début. Tout se termine bien, c’est drôle, éventuellement on pleure un peu aussi, et c’est bon ! Ca devrait être remboursé par la Sécu tellement ça fait du bien.
Au palmarès de mes films de filles à moi, quelques valeurs sûres, genre DVD de secours, vus plein plein de fois :
- Pretty Woman (Julia Roberts – Richard Gere)
- Coup de foudre à Notting Hill (Julia Roberts – Hugh Grant)
- Quand Harry rencontre Sally (Meg Ryan – Billy Cristal)
- Nuits blanches à Seattle (Meg Ryan – Tom Hanks)
- Baby boom (Diane Keaton et un peu Sam Shepard à la fin)
- Love actually (ils ont fait très fort en casting : Hugh Grant – Liam Neeson avec même un petit peu de Claudia Schiffer – Colin Firth – Emma Thompson – Keira Knightley)
Vous noterez une présence marquée de Meg Ryan, grande spécialiste de la comédie romantique, Hugh Grant qui excelle dans le genre beau maladroit (par ailleurs héros génial du mètre-étalon du film de filles « Quatre mariages et un enterrement »), et Julia Roberts à la corde.
Attention, ceux mentionnés ci-dessus sont de « bons » films de filles (selon mes critères perso qui n’engagent que moi), pas gnan-gnan, bien écrits et réalisés, parce que dans le genre, il y a du bâclé et du malodorant (façon eau de rose qui a tourné). J’ai souvenir d’un truc avec Jennifer Lopez - en femme de chambre - et le pauvre Ralph Fiennes dont on se demandait ce qu’il était venu faire dans cette galère, beurk, rien que de l’ennui à cent sous de l’heure !
Il y a d’autres films que j’homologue « films de filles », bien que ne faisant pas partie de la catégorie « comédie romantique » mais qui répondent quand même à la définition. Par exemple « Speed », qui est plutôt dans la catégorie « action adrénaline ». Mais bon, il y a Keanu Reeves, et j’avoue que Keanu, c’est mon péché mignon tellement il est beau (sauf dans « Little Bouddha » où il est étrangement coiffé comme Simone Veil et on a beau dire, une coiffure pareille, même sur Keanu Reeves, c’est pas sexy sexy), et puis il y a Sandra Bullock, que je ne peux m’empêcher de trouver sympathique bien qu’elle ait tourné à peu près autant de navets que Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal réunis.
Bref, quand je vois un potentiel film de filles, je le loue pour le tester, et si ça fonctionne, j’achète. Il faut toujours avoir un film de filles chez soi. Je ne rigole pas avec ces choses-là.
Hier donc, il s’agissait de « The Holiday », avec Cameron Diaz, Kate Winslett et Jude Law, du beau linge. Bon, cru moyen, en fait. Je ne l’achèterai pas. Scénario écrit à la truelle : une américaine (Cameron Diaz, formidable actrice de comédie) surbookée, stressée, venant de larguer son mec à trois jours de Noël, échange en trois clics sur internet sa sublime maison californienne contre le mignon cottage anglais de Kate Winslett, en pleine déprime après l’annonce du mariage du mec qu’elle aime sans espoir depuis des années. Elle vont toutes deux se recaser avant la fin du film, l’anglaise avec un musicien pas beau mais sympa, et Cameron Diaz avec le frère de l’anglaise qui se trouve n’être autre que Jude Law. Ben voyons. Cherchez pas, ça n’arrive pas dans la vie, ça !
Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films – de filles ou autres, d’ailleurs – y’a des tas de trucs qui ne se passent pas comme dans la vie. Des tas.
Par exemple la pluie.
Je crois que si je réalisais des films, je ne ferais JAMAIS de scène de pluie. C’est souvent nul, la pluie au cinéma, alors que j’aime bien la pluie, en vrai. Au cinéma, il ne bruine pas, il ne crachine pas, il ne pleuviote pas, la pluie n’arrive pas progressivement en annonçant gentiment sa venue par quelques gouttes disséminées. Non, parce qu’au cinéma, on dit Moteur et puis on fait un signe au gars qui gère le camion-citerne où qu’il y a la pluie dedans. Il ouvre le robinet, et vlan ! Une drache monstrueuse. Des trombes. Des cataractes illico. Sinon ça ne se voit pas à l’écran. Et Sophie Marceau a les cheveux qui dégoulinent et peut concourir pour le titre de Miss T-shirt mouillé en douze secondes chrono.
Il y a plein de bizarreries comme ça, n’empêche, au cinéma. Tiens, vous n’avez jamais remarqué, quand un gus fait sa valise au cinéma, il ne plie pas bien ses vêtements comme vous et moi pour que ça tienne et que ça ne se froisse pas. Non, non, la fille qui fait sa valise, elle est toujours pressée, elle prend la fuite ou un truc comme ça, alors en général elle attrape toutes ses fringues par paquets entiers sans choisir dans sa penderie et les flanque en vrac dans sa valise AVEC LES CINTRES ! Franchement, est-ce que vous n’avez pas vu cette scène des dizaines de fois au cinéma ? Nom d’un chien, moi qui ait un mal fou à voyager léger et à faire tenir tout ce que j’emporte dans mes valises, qu’est-ce que ça serait si j’y mettais les CINTRES ! Et je vous prie de croire que ma mère me ferait une tête au carré si je repartais de Bretagne en lui embarquant tous ses portemanteaux…
Quoi d’autre, d’étrange et qui me fait rire, ou m’agace, selon les cas et mon humeur ? Ah oui, je songe parfois à me reconvertir dans la police quand je vois la taille des appartements des flics au cinéma ou à la télé. Nom de nom, ça gagne méga-bien sa vie un inspecteur ! Ils ont de ces lofts en plein Paris, le rêve…
Ah, alors sinon l’autre soir, dans mon film de filles pas génial, il y avait une scène que je commence à voir de plus en plus dans des films ou des séries (vu dans la dernière saison d’Alias, notamment), et qui me plonge dans la perplexité la plus profonde. Cameron Diaz rencontre Jude Law, donc, au fin fond de la campagne anglaise, vu qu’il ignorait que sa sœur était partie subitement aux States pour Noël et qu’il était bêtement venu sonner chez elle (oui, parce que dans les films, c’est cool, vous pouvez partir à l’autre bout de la planète sans prévenir votre famille que vous ne passerez pas Noël avec eux cette année. Je vois la tête de ma mère si je lui fais un coup pareil…).
Parenthèse à propos de Jude Law ou assimilés : rêvez pas les filles. Si vous ne rencontrez pas l’âme sœur, ne pensez pas qu’aller vous enterrer au fin fond de la jungle, de la brousse, de la savane, de la campagne profonde ou sur une île perdue va vous faire rencontrer l’homme de votre vie, parce que vous avez vu ça des milliers de fois dans les films : ça n’arrive qu’à Katherine Hepburn de tomber sur Humphrey Bogart au fil d’un fleuve africain, qu’à Meryl Streep de croiser Robert Redford dans sa ferme tout aussi africaine. Il n’y a que cette garce de Diane Keaton que j’adore pour dégoter un Sam Shepard dans les congères d’un bled du Maine, et je crains de devoir vous dire que le seul homme parlant votre langue sur un atoll paumé a fort peu de chances d’être Harrison Ford. Fin de la parenthèse.
Donc Cameron et Jude tombent nez à nez, et bientôt dans les bras l’un de l’autre, et beaucoup plus car affinités. On les retrouve au petit matin (ben oui, on est dans une comédie SENTIMENTALE américaine, les gars, pas dans « 37,2° le matin »). Ils sont béats, ont la peau un peu et joliment brillante, vaguement essoufflés après cette nuit que l’on essaie de nous faire croire torride. Ils rejettent les draps au loin tellement ils ont chaud et… Cameron porte un soutien-gorge. Cherchez l’erreur.
Oui parce que vous je ne sais pas (enfin quand je dis vous, ça ne concerne que les filles), mais moi quand je passe une nuit torride avec un monsieur, que ce soit Jude ou quelqu’un d’autre d’ailleurs (enfin avec Jude, pour l’instant, c’est assez calme j’avoue... mais j'm'en fous, je préfère Keanu), et bien – sauf perversion particulière du monsieur, car c’en serait une, quasiment – je ne me réveille pas avec mon soutien-gorge. Je n’ose même pas imaginer d’ailleurs à quel point ce doit être inconfortable pour dormir, surtout un balconnet avec des armatures (et c’est en général ce qu’on porte quand on veut séduire un monsieur). J’en suis restée comme deux ronds de flan tellement c’était ridicule.
Si les actrices ne tiennent pas à exhiber leurs seins à l’écran, ce que je trouve parfaitement légitime, on pourrait peut-être régler le problème « à l’ancienne ». Autrefois, quand on voyait les héros au réveil, la fille avait le drap remonté au-dessus de la poitrine, les épaules sans bretelle apparente et ça allait bien comme ça, c’était même plus sexy. La soutien-gorgite aiguë au réveil tend à se propager dans les films, je vous assure. Même en France, on devient puritain : je ne sais ce qu’il en sera dans le n° 2, mais je me souviens que dans « Le cœur des hommes », toutes les actrices portaient le leur en se réveillant énamourées aux côtés de leurs amants. Ca m’avait fait bien rire.
Bon, je repars à la chasse de mon prochain film de filles, de préférence pas trop anachronique et irréaliste, et puis sympa et futé et drôle et émouvant. Oui, tout ça. Je lance d'ailleurs un appel aux amatrices du genre : si vous avez des titres de films de filles - avec ou sans soutien-gorge - à me suggérer, je suis preneuse ! Merci !









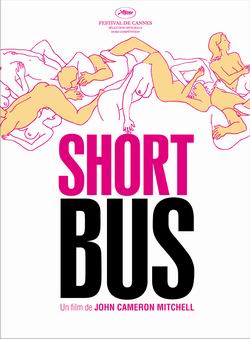








 J'ai appris ce matin la sortie du "Baleinié 2", et ai semé la panique chez Virgin ce midi en allant le réclamer illico. Pas encore arrivé. Mais j'ai fait fleurir des sourires et des lueurs de plaisir dans les yeux des vendeurs et vendeuses à qui j'ai appris la nouvelle.
J'ai appris ce matin la sortie du "Baleinié 2", et ai semé la panique chez Virgin ce midi en allant le réclamer illico. Pas encore arrivé. Mais j'ai fait fleurir des sourires et des lueurs de plaisir dans les yeux des vendeurs et vendeuses à qui j'ai appris la nouvelle. ... que j'aurais un jour dans ma discothèque un disque de Nana Mouskouri, j'aurais bien ri !
... que j'aurais un jour dans ma discothèque un disque de Nana Mouskouri, j'aurais bien ri !