"Dans la main du diable" ou le rapt de l'écriture
Par Traou le vendredi 14 août 2009, 19:16 - Mots des autres - Lien permanent
J’ai lu en cet été paresseux – quoique très occupé de cette paresse, le temps coule sans que je m’en aperçoive – « Dans la main du diable » de Anne-Marie Garat, que l’on m’avait offert il y a quelques mois et dont je reportais l’abord, à cause de son millier de pages dans sa version poche chez Babel (édition originale Actes Sud), et aussi parce que je lis finalement fort peu à Paris, hormis dans les transports en commun (je ne lis que très rarement au lit, par exemple, la position m’est inconfortable et je baille au bout d’une demi-page).
Je me suis donc a(ban)donnée avec délices à la lecture de ce pavé, des heures durant, dans mon jardin principalement et aussi dans mon lit au cœur de la nuit, incapable de lutter contre l’appel invincible des péripéties vécues l’année 1913-1914 par Gabrielle Demachy, héroïne magnifique, et la galerie de personnages rencontrés par elle au cours de ces aventures. « Dans la main du diable » est de ces livres pour lesquels on repousse le sommeil pour tourner une page de plus, puis encore une autre, sans fin, pour connaître la suite, oh si, encore un petit peu et après j’éteins, après celle-là, absolument. La prochaine…
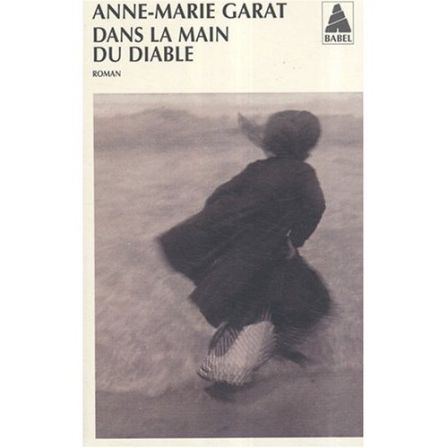
Il est de ces romans qui font trembler de plaisir, de peur délicieuse, de compassion non feinte pour les épreuves des personnages, de frissons sensuels et de cœur battant. On y sent des parfums, on y entend le bruit des foules et le murmure des complots, on partage l’émoi des amours débutantes et l’élan fougueux des amants. On y vit des deuils terribles et l’on se réjouit des trêves. On a envie de rassurer les héros, de leur dire que ça va s’arranger, forcément, ce serait trop horrible si… Et l’on referme le livre avec un rien de chagrin.
« Dans la main du diable » est de ceux-là et je ne saurais trop conseiller sa lecture aux amateurs de fresques romanesques, de feuilletons à rebondissements passionnants, de plongées dans un monde inconnu peuplé de mille histoires. Je vous laisse en découvrir les tours et les détours palpitants, et ne vous en ferai pas ici de résumé ou autre analyse (le style est remarquable et aussi foisonnant que l’intrigue, avec des consonances et tournures propres à l’époque), je ne veux évoquer que mon plaisir et remercier l’auteur pour son grand talent.
Je me suis précipitée sur le net, une fois l’ouvrage refermé, soulagement et regrets mêlés, pour connaître les autres romans d’Anne-Marie Garat, que je lisais pour la première fois. J’ai découvert que je connaissais son visage (d’où, je ne sais pas, une impression de l’avoir déjà croisée) et que « Dans la main du diable » avait une suite, que je me promets de découvrir prochainement, après une petite pause peut-être (c’est épuisant !), pour retrouver en héroïne, autour de la deuxième guerre mondiale cette fois, et en jeune femme, la petite Millie de 4 ans de la «Main du diable », et savoir ce qu’il est advenu de Gabrielle, son institutrice, laissées toutes deux sur le pont d’un transatlantique à l’orée de la Grande Guerre.
J’ai lu aussi, magie du net, des interviews de l’auteur, des présentations de la dame, engagée et plutôt sympathique, amoureuse de la fiction et du cinéma qu’elle a enseigné (l’œuvre regorge de références cinématographiques).
J’ai été fort intéressée (interpellée, dirais-je, si ce terme ne m’agaçait pas) par ses propos sur l’écriture elle-même, qu’elle définit comme un « rapt ». Et sur le fait qu’elle ait pris une fois une année sabbatique pour écrire, qui s’est avérée stérile, avant de réaliser que de jongler entre famille, activité professionnelle et temps de création était un mode de fonctionnement qui lui convenait et parfaitement propice à l’écriture dans son cas.
Bon, sans doute chacun a-t-il un mode de fonctionnement particulier concernant l’écriture ou toute forme de création, mais j’avoue que – au vu du talent de la dame et de la qualité et quantité de sa production – je me suis sentie un peu bête, moi, avec mes proclamations de mon incapacité à écrire autre que du format court, étant donné mes activités (professionnelles, amicales et de loisir seulement, je ne peux même pas me réclamer d’une famille).
Sans doute l’écriture ne m’est-elle qu’un agréable divertissement dilettante, même si je le pratique depuis que je sais tenir un crayon entre mes doigts et que j’aurais du mal à m’en passer, et non le « rapt » dont elle parle.
Je l’ai parfois évoqué ici, j’ai un projet d’écriture plus élaboré que les billets de ce blog, entamé l’année dernière, un roman en l’occurrence (j’ai également un scénario, achevé celui-là, que j’essaie de remanier pendant ces vacances, mais l’écriture scénaristique est très différente). Or ce roman, je n’arrive pas à en voir le bout, et j’envisage parfois la possibilité de m’arrêter de travailler provisoirement pour l’achever (il y a encore du boulot !), ne voyant pas d’autre possibilité pour ma part. Est-ce un leurre ?
Est-ce que, quand l’écriture vous est une réelle urgence, on ne trouve pas le temps pour elle, de quelque façon que ce soit ? Je connais des gens – publiés - qui écrivent par petits bouts, une heure par jour, avant le lever des enfants, après leur coucher, avant le boulot, entre deux, sur un coin de table, à tout prix, avec souvent une réelle discipline, pour arriver à trouver l’énergie et la concentration nécessaires au cœur d’un planning infernal. Et qui y arrivent. Moi non.
Je crois que je suis fondamentalement une paresseuse. Très active, mais paresseuse, et procrastineuse-née. Et que j’aime l’écriture, mais la vie aussi, qui me réclame, qui m’accapare. Il y a les plaisirs et les rires à entretenir, les larmes et le vin à verser, les moments amicaux à partager et l’intensité d’une tâche professionnelle à passionner, les rues à arpenter, les gens à regarder, à écouter. Il y a des dialogues émouvants et des moments à ne pas perdre, d’autres précieux à ne rien faire, si doux, les petits riens du quotidien à humer ou supporter, les petites misères à faire semblant d’ignorer et les secondes, les minutes, les heures, à vivre sans les compter. Quand je vous dis que je suis très occupée !
Pourtant j’aime quand l’écriture me submerge. Quand je m’y perds, quand je m’y noie. Quand je vis avec mes personnages, confondue en eux, mon souffle sur leur bouche, mes larmes dans leurs yeux, leur rire jaillissant de moi, leurs émotions à fleur de ma peau. J’ai souvenir d’avoir perdu parfois le fil du temps au gré de leurs émois et pérégrinations qui naissaient sous mes doigts au même rythme que mon cœur, de relever la tête, surprise du jour couchant, affamée d’un coup, emportée que j’étais avec eux depuis le petit matin, sans trêve. Vertigineux.
C’est un vertige que je n’arrive pas à recréer au quotidien, un fil que je n’arrive pas à renouer sur commande, juste pour une heure, je n’y parviens pas, je n’en ai peut-être pas l’urgence ? Que faire ?
Pour l’instant mes personnages dorment, et ils me manquent, mais je n’arrive pas à m’organiser de rendez-vous quotidien avec eux. Je ne les ai même pas emmenés avec moi durant ces vacances, que je voulais consacrer au « rien », et à mon scénario en priorité sur lequel il y a moins de travail à apporter et dont je voudrais peut-être essayer de faire quelque chose à la rentrée, puisque ses premiers lecteurs ont eu la bonté d’y trouver quelque intérêt.
Je refuse de me contraindre à l’écriture. Elle vient sous mes doigts si elle veut, comme elle peut, je ne peux en faire un devoir, je l’accepte comme elle me visite, légère, et si elle me rend heureuse. Je peux écrire parce que je souffre, mais pas dans la souffrance d’écrire… Or donc, je crois que je vais m’accepter en dilettante des mots et, sauf solution non encore imaginée (un mécène, une potion magique, une crise aiguë qui me jetterait à corps perdu dans la création et ravalerait la fresque de 1000 pages d’Anne-Marie Garat au rang d’historiette…), je crois bien que je vais me satisfaire encore quelques temps au moins de ce format court dans lequel je me sens à l’aise, de mon statut de picoreuse d’écriture (c’est mignon, picoreuse, je m’en ferais bien un titre de carte de visite), et ne pas m’angoisser de ne pas ou « pas assez » écrire.
Il n’y a pas d’obligation, pas de besoin. On écrit ce qu’on doit. Point. Ce blog et mes quelques pages en dehors sont peut-être mon écriture à moi. Ni plus. Ni moins.
Commentaires
J'aime ce que tu écris sur l'écriture. Le "rapt" est ce que je ressens.
Après qu'on ait besoin ou non d'une autre activité, c'est tellement une question d'équilibre de chacun, d'énergie disponible et de fatigue aussi.
Moi j'ai besoin, comme toi, de la vie vivante, le retrait ne me va pas. En revanche je sais qu'une autre activité professionnelle, si elle ne m'empêche pas d'avancer me nuit : je m'épuise à faire les deux et comme l'écriture je ne peux l'empêcher ça me vide la santé.
Pour d'autres c'est l'inverse, ils ont besoin de l'écriture comme contrepoids, en contrepoint et écrire et ne faire rien d'autre font qu'ils ne font rien.
Pour moi l'idéal est ce que je vis en ce moment : différents chantiers d'écriture à différents stades, menés de front et ne nécessitant donc pas les mêmes aptitudes, ne mettant pas en jeu les mêmes capacités. Il y a celui qui est en relecture et avec lequel il me faudra à partir de septembre entamer la tournée des refus, le douloureux "en cours", et un doux jeunesse pour décompresser. La seule chose qui me permettrait de mieux avancer serait de cesser d'abuser des chagrins d'amour.
On ne peut pas tout avoir. Et ce qui m'est à présent offert tient de l'immense privilège (après des années d'en baver).
De l'internet je ne saurais me passer : c'est mon biotope, mon lieu de naissance, les premiers lecteurs en mon nom.
C'est bien que chacun trouve son rythme, sa façon. Tu as raison de dire qu'il ne faut pas forcer, jamais. D'ailleurs de belles œuvres, celles que j'appelle les "That's it", sont nées de diversions nécessaires, de projets principaux qui cessaient d'avancer et en attendant une éclaircie l'auteur prenait un chemin de traverse, lequel se révélait mener quelque part.
Et puis surtout ce n'est pas parce que tu ne ressens pas de "rapt" qu'il faut penser que tu n'es pas appelée à écrire du bon et qui sera utile aux autres.
Si tu te sens mieux en court, pourquoi ne pas tenter un recueil de nouvelles (si pas déjà fait, j'ai un trou de mémoire, là) ?
Coup de chapeau à la qualité de ton écriture et clin d'œil complice sur le désir d'écrire sans urgence… ;-)
J'aime beaucoup, aussi, ce que tu écris sur l'écriture ; ta façon et ta passion et ta lucidité.
Nom de gnou que j'aime ta dernière phrase ! :-)
Ah, le fantasme de l'écriture quotidienne ! Rire, s'astreindre à son labeur quotidien, ça fait rêver ... Rire ... Mais chacun fait comme il peut. Pour ma part, j'ai besoin d'abord de temps pour rêver. Quand je me mets à écrire, ça va vite, parce que j'ai déjà beaucoup rêvé, et c'est là parfois que la vie, "trépidante" de maman surtout ces dernières années, freine mon travail. Il y a une expression détestable qui parle de temps de cerveau disponible. Mais oui, d'une certaine façon, c'est avant tout de cela dont j'ai besoin. Quand j'ai eu le temps de bien rêver, je suis souvent étonnée de la vitesse à laquelle j'écris. Et puis de petits bouts en petits bouts, on peut faire une œuvre, comme les cailloux du petits poucet ;-)
J'aurais pu écrire ce billet, si ce n'est sur la forme, sur le fond.
Formons un gang d'amateurs dilettantes ! (Comment ça, on le fait déjà ?!!)
Eh bien, Traou, que devenez-vous ?
Tu es la plus jolie des picoreuses ;)